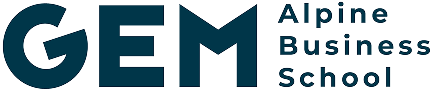Les territoires sont la terre d’action de la transition énergétique
Deux recherches précurseurs sur l’éolien, en France, ont précédé le projet d’étude portant sur la méthanisation, mobilisant l’énergie de la Chaire Energy for Society ces derniers mois : « Nos méthodes d’investigation ont pour but de tester l’efficacité de nouvelles mesures/solutions business permettant de concilier l’attractivité business et l’appropriation par les citoyens », relève Carine Sebi, professeure d’économie à GEM, spécialiste du secteur de l’énergie et titulaire de la Chaire Energy for Society. L’ambition ? Améliorer l’adhésion sociale portant sur les technologies de la méthanisation.
Une étude inédite sur la méthanisation
« Notre méthodologie d’étude sur les enjeux de la méthanisation, s’est révélée très différente au regard de nos précédentes recherches. Nous avons adapté des applications qualitatives, issues du management de l’innovation afin de pouvoir déceler de nouveaux business models. En effet, la méthanisation campe un large panorama dans l’ensemble du territoire métropolitain. Les infrastructures s’avèrent très diversifiées en Bretagne, dans les Vosges, en région AuRa… On parle de « types de méthanisation. C’est une filière qui s’apparente à celle de l’industrie. Nous sommes là à la croisée de l’agriculture, de l’énergie et du monde des déchets. Et nous sommes, de fait, confrontés à des domaines, des mondes et des langages différents. »
Accroître l’acceptabilité sociale pour instaurer des business models efficients
La méthanisation participe à la décarbonation de notre mix énergétique. Au-delà, la crise ukrainienne a rappelé l’importance de diversifier nos sources d’approvisionnement en énergie, à commencer par le gaz. « Au-delà du bénéfice énergétique, la méthanisation est une économie circulaire locale, qui comporte d’autres avantages majeurs, comme celui de générer un complément de revenu pour les agriculteurs, ou la possibilité de valoriser localement des déchets qui traversent aujourd’hui la France. Mais la méthanisation suscite aussi des inquiétudes et des contestations. Comment faire en sorte que les intérêts publics ou privés ne se transforment pas en effets indésirables pour d’autres ? » interroge Carine Sebi.
Pour résoudre cette équation, Eduardo Mendez Leon, Anne-Lorène Vernay et Carine Sebi, enseignants-chercheurs à GEM et instigateurs du projet sur la méthanisation, ont enquêté auprès des principales parties prenantes de la filière : les riverains, les ONG, les agriculteurs, les développeurs de projets, les industriels et énergéticiens. En octobre 2023, plus de trentaine d’entretiens qualitatifs ont été réalisés. « Les questions centrales ont porté sur la compréhension des différents procédés de méthanisation, leurs avantages et surtout leurs inconvénients », précise Carine Sebi. Ces trois données devraient servir de support à l’acceptabilité sociale de la technologie.
Sur le terrain, les process de méthanisation, à l’instar d’autres sources d’énergies renouvelables, recourent à des infrastructures décentralisées dans les différents territoires métropolitains. « Ces projets décentralisés accroissent les points de friction entre les diverses parties prenantes : ces tensions augmentent les coûts (et les temps de mise en œuvre) liés au développement pour l’ensemble de la filière, portent préjudice à la société dans son ensemble, et impactent l’environnement. »
Les conditions de réussite
L’enjeu de comprendre les facteurs de résistance et les facteurs d’acceptabilité est donc central pour réduire les temps de développement et de mise en œuvre des nouveaux modèles. Les résultats de l’étude pointent les orientations suivantes :
- Les porteurs doivent démontrer qu’ils complètent plutôt qu’ils ne se substituent à l’activité agricole et qu’ils n’encouragent pas la production de déchets : la méthanisation doit être un débouché et non un moteur.
- Le dimensionnement des projets doit être en adéquation avec le territoire dans lequel il s’implante, en tenant compte de la quantité de digestat produite en fonction des terres disponibles pour l’épandage et de la disponibilité locale de matière organique afin de minimiser son transport.
- La transparence envers les parties prenantes locales est indispensable avant même de déposer une demande de permis.
« Pour garantir ces conditions, et concilier des enjeux à la fois agricoles, énergétiques et industriels, l’Etat doit contrôler l’application des réglementations en vigueur. Localement, les collectivités doivent être soutenues dans l’exercice de leur responsabilité en matière de planification territoriale, afin d’assurer la cohérence entre les enjeux locaux et les ambitions nationales », conclut Carine Sebi.