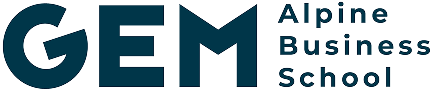Plongée dans l’Innovation Territoriale avec un acteur clé du ZAN
3 question à Benoît Parent, directeur du Scot de la grande région grenobloise.
Quels ont été les facteurs qui vous ont conduit à participer au parcours 2023/2024 du catalyseur de l’innovation territoriale, organisé par la Chaire des Territoires en Transition (TeT) de Grenoble Ecole de Management ?
« J’entretiens des relations au long cours avec Thibault Daudigeos, doyen associé à la recherche, professeur et co-fondateur de la chaire TeT, notamment lors que j’étais à l’Agence d’urbanisme de la région grenobloise (AURG). La chaire témoigne d’une capacité à aborder les politiques territoriales de façon croisée et complémentaire à celle d’un organisme d’ingénierie. L’établissement public du Scot de la grande région grenobloise regroupe des collectivités territoriales (intercommunalités) et assure la maîtrise d’ouvrage du document « SCoT ». Nous sommes en première ligne avec les complexités d’application de la loi ZAN.
La question du ZAN est au cœur des solutions prospectives, élaborées par le catalyseur de l’innovation territoriale – un dispositif pilote de réflexions et d’actions collégiales, porté par la chaire TeT de GEM. Quelles sont vos attentes vis-à-vis de ce dispositif ?
Les collectivités et l’ensemble des acteurs du territoire doivent rompre aujourd’hui avec plus de 50 ans d’aménagement du territoire. La rupture traduite par le ZAN interroge tous les modèles. Et, parfois, on ne sait simplement pas encore faire… Le catalyseur de l’innovation territoriale, consacré au ZAN, apporte clairement une première pierre à l’édifice.
La question du ZAN est un moyen et non une fin. L’incidence de son application va être forte dans différents domaines. La question posée par ce dispositif est de savoir comment penser le territoire de demain, collectivement. Tous les acteurs qui seront impactés devraient participer. Le cadre qui est posé par ces échanges collégiaux, adopte une méthode très dynamique qui permet un regard décalé sur la problématique du ZAN. Le management de projet en est la pierre angulaire. Cette méthodologie permet d’enrichir notre approche du ZAN et d’en mesurer la complexité. Car il n’existe pas « une » solution mais « des » solutions. La participation d’acteurs multiples au dispositif amène à rester modeste et pragmatique.
Quels sont les premiers apports de votre participation aux ateliers ?
Le Scot de la grande région grenobloise est le plus grand Scot de la région Auvergne-Rhône-Alpes. La très grande variété des territoires concernés – depuis le Trièves jusqu’au cœur de la Métropole en passant par les territoires de Belledonne, du Voironnais, de la Bièvre et de Saint Marcellin– génère une complexité accrue à la mise en œuvre du ZAN, tout en permettant des solidarités et des complementarités. Les règles sont certes collectives, mais doivent se traduire de façon différentes selon les territoires.
Je relève plusieurs bénéfices à l’issue de ces partages : le travail proposé par Mark Olsthoorn, professeur et chercheur à GEM, autour des des #wickedproblems (problèmes aux solutions complexes) a été particulièrement intéressant pour dénouer la complexité du ZAN. Les apprentissages, en terme de posture, sont importants.
Par ailleurs, en tant que professionnel de l’aménagement du territoire, j’ai plutôt une bonne connaissance du contenu de la loi sur le ZAN, par rapport à d’autres acteurs impliqués dans le cycle. L’intérêt majeur de ces ateliers est de me permettre d’adopter une attitude d’ouverture et de demeurer à l’écoute de toutes les problématiques abordées par les parties prenantes du territoire : citoyens, notaires, entreprises du BTP, etc. L’objectif du catalyseur est bien de rester connecté afin de pouvoir travailler avec des partenaires diversifiés. Car le ZAN peut être vite technique et faire perdre le sens dans la démarche. L’initiative de la chaire TeT permet de donner des clés à chaque intervenant et de ramener ces enjeux sur le terrain de tous les interlocuteurs. C’est essentiel.